Elisa Beiram, Le premier jour de paix
« Que ces connaissances, ces savoir-faire, ces biens demeurent à jamais inappropriables, et régis par le seul droit d’usage. Qu’ils ne pourront être accaparés par un individu ou un groupe d’individus à des fins d’accumulation ou de manipulation des ressources disponibles. »
Avec Le Premier jour de paix, Elisa Beiram insuffle l’espoir de l’utopie en pleine Rentrée Littéraire caniculaire. Un roman dense, malin, très réussi, qui apaise et appelle à l’action. Le bol d’air frais que l’on attendait.
L’humanité sur le fil

Ce roman débute en Colombie, dans un monde dévasté par les guerres et les famines. Le XXIème siècle n’a pas été tendre avec l’humanité, à moins que ce soit l’inverse. Aureliano est un utopiste désabusé. Il croit en la non-violence, mais dans sa communauté qui s’entre-tue, il semble être le seul. Il attend donc son tour en bâtissant un mausolée idéal avec des déchets rejetés par l’océan, comme un Facteur Cheval de fin du monde.
Mais certains n’ont pas abandonné la paix, et oeuvrent dans le monde pour sauver l’humanité, pour réparer nos erreurs passées, pour atteindre cet utopique « premier jour de paix », premier jour sans violence, sans guerre, sans bataille, sans conflit. La tâche est rude, mais l’espoir a-t-il lieu d’être ? Tout n’est-il pas déjà perdu ? Malgré les doutes qui la traversent, Esfir, émissaire de paix, parcours inlassablement le monde pour résoudre les conflits, les disputes, parfois de simples vexations qui évoluent en guerres civiles.
Ce roman commence dans un contraste étonnant : la violence qui décime la communauté d’Aureliano et le calme de la plage sur laquelle il construit peu à peu son mausolée. Comme si l’humanité avait finalement déjà un pied dans la tombe, et que régnait en surplomb le sentiment désabusé que la Terre continuerait de tourner sans elle. L’avenir de l’humanité est incertain, sur un fil, entre un salut inespéré et le précipice.
Se débattre et survivre
Mais ailleurs, l’humanité se bat. Les gouvernements, ou ce qu’il en reste, se débattent dans la mêlée pour garder un sentiment de pertinence alors qu’il semble de plus en plus clair qu’ils sont un obstacle sur la route de l’utopie et non la solution. Partout dans le monde les communautés s’organisent en autonomie, tant bien que mal, au beau milieu d’une Terre en voie de désertification où subsistent encore quelques oasis à préserver.
Car oui, dans ce roman, Elisa Beiram n’y va pas par quatre chemin pour nous décrire notre avenir. Et comment la crise climatique entraîne une crise politique, une crise humanitaire, amène avec elle le conflit et la guerre : prendre soin de l’environnement, c’est prendre soin de l’humanité. Et terminé, nous dit Esfir, l’espoir idiot d’émigrer dans un autre monde alors qu’on a cramé celui-ci : « Comment avait-on pu envisager de terraformer un monde lointain et glacial, alors qu’on ne s’était montré capables que de déterraformer le seul qu’on avait ?«
Elle décrit une humanité qui, malgré tout, veut survivre. Qui se débat, même désabusée, même en trainant les pieds, même dans la dispute. Mais comment passer de l’instinct de survie, ce sentiment animal qui est souvent le sommet de tout roman post-apocalyptique, à l’espoir ?
Atteindre l’utopie
Voilà à quoi s’attellent les émissaires de paix, qui parcourent le monde pour tenter de résoudre le moindre conflit : dispute de voisinage, vendetta en devenir, vexations idiotes… Dans un monde en perte de repères, la paix est un apprentissage quotidien. À chaque conflit à résoudre, Esfir cherche la faille qui fera renaître le dialogue. Et parfois dans un sentiment, inattendu, d’abandon. Ainsi, le « balek » désabusé d’un jeune devient l’instrument d’un espoir plus grand : la paix par l’indifférence.
Mais l’utopie ne peut pas se reposer sur la résolution apolitique des petits conflits. L’humanité doit réparer ses erreurs avant d’espérer atteindre la paix. Le capitalisme a mené l’humanité à sa perte : source de conflits, assèchement de la planète et de ses ressources, la cupidité et l’accumulation de richesses a aveuglé les puissants au point de leur faire prendre les pire décisions. Alors au bord du précipice, et alors qu’ils s’accrochent à l’illusion d’être encore utile à quelque chose, les gouvernements prendront-ils la bonne route ?
Et finalement, les plus grands espoirs ne sont-ils pas dans les mains de l’humanité qui se reconstruit sans jeter un regard vers ceux qui pensent les gouverner ? Elisa Beiram nous parle d’une humanité en reconstruction, des communautés qui s’organisent, même de manière imparfaite, en recherche de l’autonomie énergétique, propre, et d’un lien plus sain et apaisé avec la nature. Une recherche, simplement, du bien commun.
Un bol d’air frais
Pas facile de construire une utopie après l’apocalypse. Si Becky Chambers avait choisi de placer la sienne (Histoires de moine et de robot) bien après et bien loin du désastre, Elisa Beiram choisit de décrire le processus, et les questionnements qui le traversent. Étonnamment, c’est un roman apaisant. La preuve, s’il en fallait, que l’on peut aborder ces questions sans panique ni angoisse. Parce que finalement, les solutions envisagées dans le livre sont déjà entre nos mains. Nul besoin d’attendre que la Terre soit un désert aride pour envisager de les appliquer. Ce roman très réussi est un bol d’air frais au milieu du désespoir caniculaire, un appel à l’action, formulé en cette devise des émissaires de paix : « Qu’un million d’entre nous essaiment pour qu’un milliard de plus apprennent.«
Bonne lecture,
Viktor Salamandre
Le premier jour de paix, Elisa Beiram, éditions L’Atalante, 15,50€
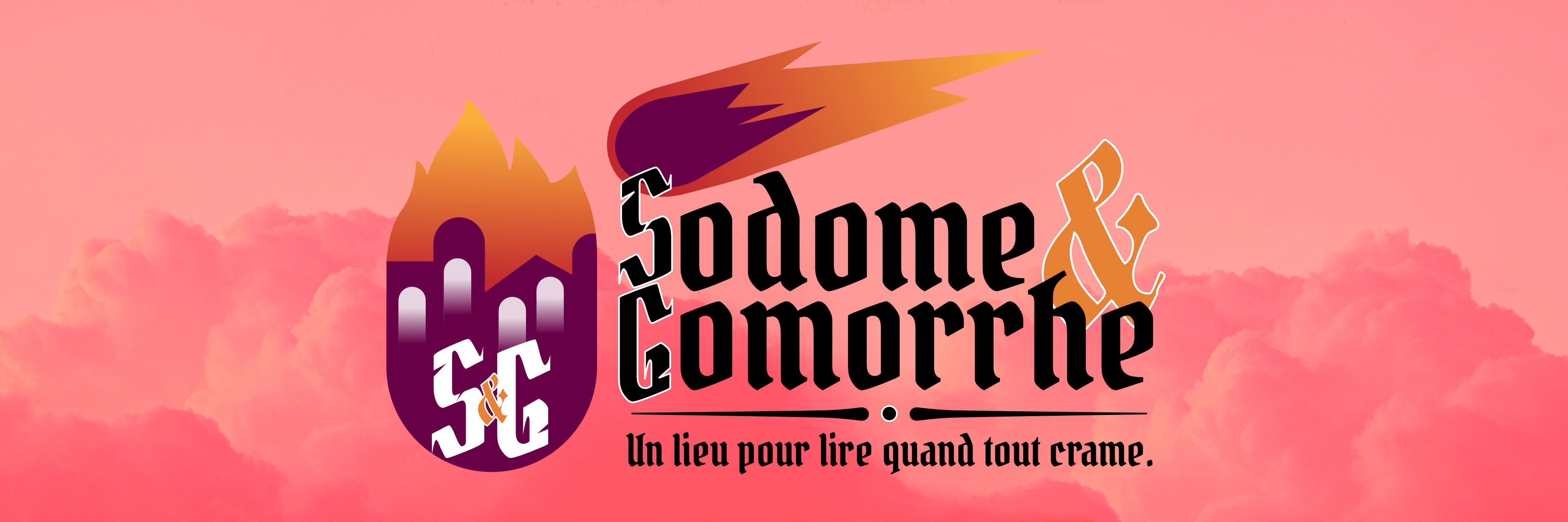

Laissez un commentaire